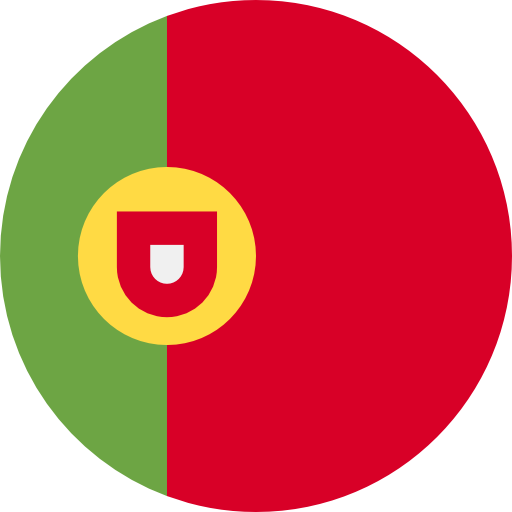
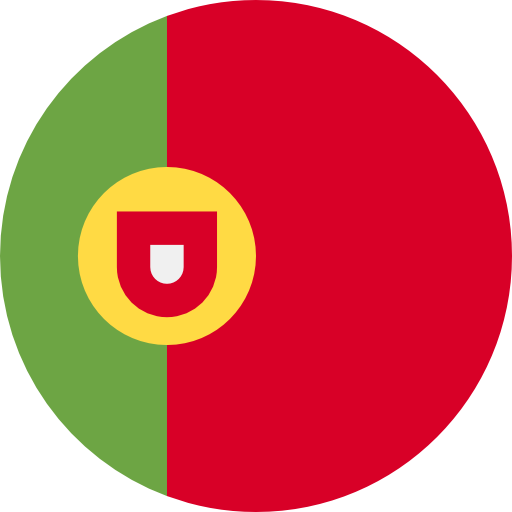
Dans les phrases complexes à subordonnée(s), l’ordre des propositions peut être libre ou fixe. Par exemple, en français, la proposition subordonnée circonstancielle causale introduite par la conjonction comme est toujours antéposée par rapport à la principale : Comme il y avait de la neige, nous avons pu skier. Par contre, le même type de subordonnée, avec la conjonction puisque, peut être antéposée ou postposée : Puisque tu ne veux pas venir, j’irai tout seul, Je ne peux pas venir, puisque j’ai mon cours de conduite.
L’ordre des mots joue un rôle dans la typologie syntaxique des langues de plusieurs points de vue, dont l’un est la place du sujet, du verbe et du complément d’objet direct l’un par rapport à l’autre dans une phrase canonique, c’est-à-dire simple, énonciative, au sujet et au COD exprimés par un nom, qui ne contient que ces trois termes, dans laquelle on n’attribue le rôle de thème et de rhème à aucun d’entre eux et on n’en met aucun en relief. On désigne ainsi six types de langues, par les sigles des mots anglais subject, verb et object : SOV, SVO, VSO, VOS, OVS et OSV.
Il y a diverses études concernant l’inclusion des langues dans ces types et le classement des types selon le nombre de langues qu’ils comprennent.
D’une étude réalisée sur 1377 langues, il ressort le classement ci-dessous :
| Type de langue | Nombre de langues | Exemples de langues |
|---|---|---|
| SOV | 565 | japonais, turc |
| SVO | 488 | anglais, français |
| VSO | 95 | irlandais, maori |
| VOS | 25 | nias |
| OVS | 11 | hixkaryana |
| OSV | 4 | nadëb |
| Sans ordre dominant | 189 |
Il est à remarquer que dans la plupart des langues, le sujet occupe la première place.
Une phrase canonique, neutre, l’est aussi du point de vue pragmatique. Dans une telle phrase, on ne fait aucun effort pour attribuer les rôles de thème et de rhème à ses parties, et on n’en met aucune en relief. Du moins dans certaines langues, dans une telle phrase, le thème occupe la première place, étant d’ordinaire le sujet (y compris les termes qui constituent son syntagme, si c’est le cas), et le rhème est tout le reste de la phrase situé après le thème. Exemples :
La phrase vue en tant qu’énoncé, c’est-à-dire dans une situation de communication donnée, n’est pas toujours canonique. C’est le locuteur ou le scripteur qui attribue les rôles de thème et de rhème en fonction de ses intentions de communication.
L’ordre peut être dans ce cas aussi thème + rhème, mais le thème ne correspond plus au sujet. C’est une autre partie de la phrase qui est thématisée et éventuellement mise en relief. Une telle phrase est souvent une réponse complète à une question, où le locuteur thématise ce qui était le rhème dans la question, bien que dans un dialogue on évite d’ordinaire sa répétition. La thématisation peut se faire par simple déplacement de la partie de phrase en cause par rapport à sa position canonique ou par déplacement associé à l’emploi de mots supplémentaires. Dans les deux cas, le mot noyau de cette partie porte l’accent le plus fort de tous les mots de la phrase. Dans certaines langues, comme le roumain ou le hongrois, c’est le premier procédé qui est le plus fréquent, dans d’autres, tel le français, c’est le second. Dans ce qui suit, on présente seulement des exemples de simple changement de l’ordre des mots.
L’ordre peut aussi être rhème + thème, par exemple dans des réponses, le thème étant d’ordinaire omis pour éviter la répétition de son contenu. Cela aussi peut se faire par mise en relief de la partie en question en tête de phrase, sans mots supplémentaires dans certaines langues, si la phrase est complète. Exemples en hongrois :
| – Kivel találkoztál ma reggel a villamoson? « Qui as-tu rencontré ce matin dans le tram ? » | – Az anyósoddal (találkoztam ma reggel a villamoson) « (C’est) ta belle-mère (que j’ai rencontrée ce matin dans le tram) » ; |
| – Mikor találkoztál az anyósommal? « Quand as-tu rencontré ma belle-mère ? » | – Ma reggel (találkoztam az anyósoddal a villamoson) « (C’est) ce matin (que j’ai rencontré ta belle-mère dans le tram) » ; |
| – Hol találkoztál az anyósommal? « Où as-tu rencontré ma belle-mère ? » | – A villamoson (találkoztam ma reggel az anyósoddal) « (C’est) dans le tram (que j’ai rencontré ta belle-mère ce matin) ». |
La mise en relief par changement de l’ordre des mots par rapport à l’ordre canonique a souvent une raison affective.
Un exemple à cet égard est, dans certaines langues, le placement avant le nom qu’il détermine, de l’épithète qui, dans un syntagme neutre, se trouve normalement après le nom. Exemples :
Le changement de place de l’attribut peut avoir la même raison :