Ruy Blas
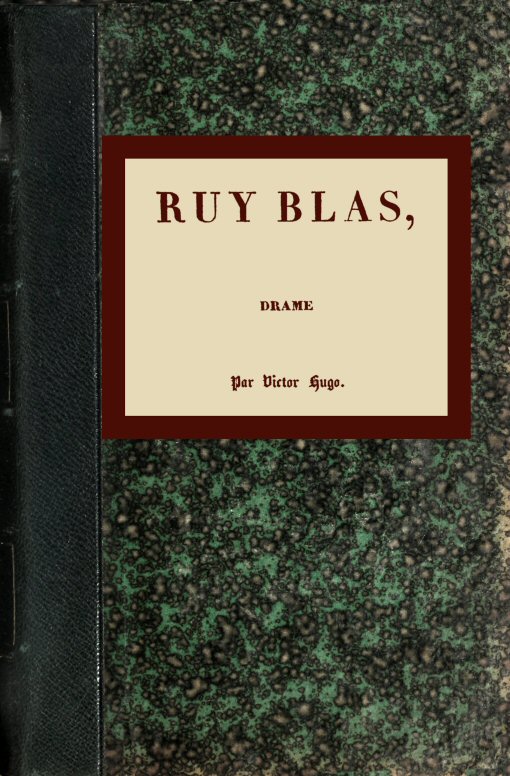

—
[
PRÉFACE .
que l'action intéresse d'ailleurs, sont si absorbées par les développements de la passion, qu'elles se préoccupent peu du dessin des caractères; quant aux penseurs, ils ont un tel goût de voir des caractères, c'est-à-dire, des hommes vivre sur la scène, que, tout en accueillant volontiers la passion comme incident naturel dans l'œuvre dramatique, ils en viennent presque à y être importunés par l'action. Cela tient à ce que la foule demande surtout au théâtre des sensations; la femme, des émotions; le penseur, des méditations: tous veulent un plaisir, mais ceux-ci, le plaisir des yeux; celles-là, le plaisir du cœur; les derniers, le plaisir de l'esprit. De là, sur notre scène, trois espèces d'œuvres bien distinctes, l'une vulgaire et inférieure, les deux autres illustres et supérieures, mais qui, toutes les trois, satisfont un besoin: le mélodrame pour la foule; pour les femmes, la tragédie qui analyse la passion; pour les penseurs, la comédie qui peint l'humanité.
[1] C'est-à-dire du style; car, si l'action peut, dans beaucoup de cas, s'exprimer par l'action même, les passions et les caractères, à très-peu d'exceptions près, ne s'expriment que par la parole. Or, la parole au théâtre, la parole fixée et non flottante, c'est le style.
Que le personnage parle comme il doit parler, sibi constet, dit Horace. Tout est là.
Disons-le en passant, nous ne prétendons rien établir ici de rigoureux, et nous prions le lecteur d'introduire de lui-même dans notre pensée les restrictions qu'elle peut contenir. Les généralités admettent toujours les exceptions; nous savons fort bien que la foule est une grande chose dans laquelle on trouve tout, l'instinct du beau comme le goût du médiocre; l'amour de l'idéal comme l'appétit du commun; nous savons également que tout penseur complet doit être femme par les côtés délicats du cœur; et nous n'ignorons pas que, grâce à cette loi mystérieuse qui lie les sexes l'un à l'autre aussi bien par l'esprit que par le corps, bien souvent dans une[p. iii] femme il y a un penseur. Ceci posé, et après avoir prié de nouveau le lecteur de ne pas attacher un sens trop absolu aux quelques mots qui nous restent à dire, nous reprenons.
Pour tout homme qui fixe un regard sérieux sur trois sortes de spectateurs dont nous venons de parler, il est évident qu'elles ont toutes les trois raison. Les femmes ont raison de vouloir être émues, les penseurs ont raison de vouloir être enseignés, la foule n'a pas tort de vouloir être amusée. De cette évidence se déduit la loi du drame. En effet, au delà de cette barrière de feu qu'on appelle la rampe du théâtre et qui sépare le monde réel du monde idéal, créer et faire vivre, dans les
conditions combinées de l'art et de la nature, des caractères, c'est-à-dire, et nous le répétons, des hommes; dans ces hommes, dans ces caractères, jeter des passions qui développent ceux-ci et modifient ceux-là; et enfin du choc de ces caractères et de ces passions avec les grandes lois providentielles, faire sortir la vie humaine, c'est-à-dire des événements grands, petits, douloureux, comiques, terribles, qui contiennent pour le cœur ce plaisir qu'on appelle l'intérêt, et pour l'esprit cette leçon qu'on appelle la morale: tel est le but du drame. On le voit; le drame tient de la tragédie par la peinture des passions, et de la comédie par la peinture des caractères. Le drame est la troisième grande forme de l'art, comprenant, enserrant et fécondant les deux premières. Corneille et Molière existeraient indépendamment l'un de l'autre, si Shakspeare n'était entre eux, donnant à Corneille la main gauche, à Molière la main droite. De cette façon les deux[p. iv] électricités opposées de la comédie et de la tragédie se rencontrent, et l'étincelle qui en jaillit, c'est le drame.
En expliquant, comme il les entend et comme il les a déjà indiqués plusieurs fois, le principe, la loi et le but du drame, l'auteur est loin de se dissimuler l'exiguité de ses forces et la brièveté de son esprit. Il définit ici, qu'on ne s'y méprenne pas, non ce qu'il a fait, mais ce qu'il a voulu faire. Il montre ce qui a été pour lui le point de départ. Rien de plus.
Nous n'avons en tête de ce livre que peu de lignes à écrire et l'espace nous manque pour les développements nécessaires. Qu'on nous permette donc de passer, sans nous appesantir autrement sur la transition, des idées générales que nous venons de poser et qui, selon nous(toutes les conditions de l'idéal étant maintenues du reste) régissent l'art tout entier, à quelques-unes des idées particulières que ce drame, Ruy Blas, peut soulever dans les esprits attentifs.
Et premièrement, pour ne prendre qu'un des côtés de la question, au point de vue de la philosophie de l'histoire, quel est le sens de ce drame? — Expliquons-nous.
Au moment où une monarchie va s'écrouler, plusieurs phénomènes peuvent être observés. Et d'abord la noblesse tend à se dissoudre. En se dissolvant elle se divise, et voici de quelle façon:
Le royaume chancelle, la dynastie s'éteint, la loi tombe en ruine; l'unité politique s'émiette aux tiraillements de l'intrigue; le haut de la société s'abâtardit[p. v] et dégénère; un mortel affaiblissement se fait sentir à tous au dehors comme au dedans; les grandes choses de l'État sont tombées, les petites seules sont debout: triste spectacle public; plus de police, plus d'armée, plus de finances; chacun devine que la fin
arrive. De là, dans tous les esprits, ennui de la veille, crainte du lendemain, défiance de tout homme, découragement de toute chose, dégoût profond. Comme la maladie de l'État est dans la tête, la noblesse, qui y touche, en est la première atteinte. Que devient-elle alors? Une partie des gentilshommes, la moins honnête et la moins généreuse, reste à la cour. Tout va être englouti, le temps presse, il faut se hâter, il faut s'enrichir, s'agrandir et profiter des circonstances. On ne songe plus qu'à soi. Chacun se fait, sans pitié pour le pays, une petite fortune particulière dans un coin de la grande infortune publique. On est courtisan, on est ministre, on se dépêche d'être heureux et puissant. On a de l'esprit, on se déprave et l'on réussit. Les ordres de l'État, les dignités, les places, l'argent, on prend tout, on veut tout, on pille tout. On ne vit plus que par l'ambition et la cupidité. On cache les désordres secrets que peut engendrer l'infirmité humaine sous beaucoup de gravité extérieure. Et comme cette vie acharnée aux vanités et aux jouissances de l'orgueil a pour première condition l'oubli de tous les sentiments naturels, on y devient féroce. Quand le jour de la disgrâce arrive, quelque chose de monstrueux se développe dans le courtisan tombé, et l'homme se change en démon.
L'état désespéré du royaume pousse l'autre moitié[p. vi] de la noblesse, la meilleure et la mieux née, dans une autre voie. Elle s'en va chez elle. Elle rentre dans ses palais, dans ses châteaux, dans ses seigneuries. Elle a horreur des affaires, elle n'y peut rien, la fin du monde approche; qu'y faire et à quoi bon se désoler? Il faut s'étourdir, fermer les yeux, vivre, boire, aimer, jouir. Qui sait! a-t-on même un an devant soi? Cela dit, ou même simplement senti, le gentilhomme prend la chose au vif, décuple sa livrée, achète des chevaux, enrichit des femmes, ordonne des fêtes, paye des orgies, jette, donne, vend, achète, hypothèque, compromet, dévore, se livre aux usuriers et met le feu aux quatre coins de son bien. Un beau matin, il lui arrive un malheur. C'est que, quoique la monarchie aille grand train, il s'est ruiné avant elle. Tout est fini, tout est brûlé. De toute cette belle vie flamboyante, il ne reste pas même de la fumée; elle s'est envolée. De la cendre, rien de plus. Oublié et abandonné de tous, excepté de ses créanciers, le pauvre gentilhomme devient alors ce qu'il peut, un peu aventurier, un peu spadassin, un peu bohémien. Il s'enfonce et disparaît dans la foule, grande masse terne et noire que, jusqu'à ce jour, il a à peine entrevue de loin sous ses pieds. Il s'y plonge, il s'y réfugie. Il n'a plus d'or, mais il lui reste le soleil, cette richesse de ceux qui n'ont rien. Il a d'abord habité le haut de la société, voici maintenant qu'il vient se loger dans le bas, et qu'il s'en accommode; il se moque de son parent l'ambitieux, qui est
riche et qui est puissant; il devient philosophe, et il compare les voleurs aux courtisans. Du reste, bonne, brave, loyale et intelligente nature; mélange du[p. vii] poëte, du gueux et du prince; riant de tout; faisant aujourd'hui rosser le guet par ses camarades comme autrefois par ses gens, mais n'y touchant pas; alliant dans sa manière, avec quelque grâce, l'impudence du marquis à l'effronterie du zingaro; souillé au dehors, sain au dedans; et n'ayant plus du gentilhomme que son honneur qu'il garde, son nom qu'il cache et son épée qu'il montre.
Si le double tableau que nous venons de tracer s'offre dans l'histoire de toutes les monarchies à un moment donné, il se présente particulièrement en Espagne d'une façon frappante à la fin du dix-septième siècle. Ainsi, si l'auteur avait réussi à exécuter cette partie de sa pensée, ce qu'il est loin de supposer, dans le drame qu'on va lire, la première moitié de la noblesse espagnole à cette époque se résumerait en don Salluste, et la seconde moitié en don César. Tous deux cousins, comme il convient.
Ici, comme partout, en esquissant ce croquis de la noblesse castillane vers 1695, nous réservons, bien entendu, les rares et vénérables exceptions. — Poursuivons.
En examinant toujours cette monarchie et cette époque, au-dessous de la noblesse ainsi partagée, et qui pourrait, jusqu'à un certain point, être personnifiée dans les deux hommes que nous venons de nommer, on voit remuer dans l'ombre quelque chose de grand, de sombre et d'inconnu. C'est le peuple: le peuple, qui a l'avenir et qui n'a pas le présent; le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort; placé très-bas, et aspirant très-haut; ayant sur le dos les marques de la servitude et dans le cœur les prémédi[p. viii]tations du génie; le peuple, valet des grands seigneurs, et amoureux, dans sa misère et dans son abjection, de la seule figure qui, au milieu de cette société écroulée, représente pour lui, dans un divin rayonnement, l'autorité, la charité et la fécondité. Le peuple, ce serait Ruy Blas.
Maintenant, au-dessus de ces trois hommes, qui, ainsi considérés, feraient vivre et marcher aux yeux du spectateur, trois faits, et dans ces trois faits toute la monarchie espagnole au dix-septième siècle; au-dessus de ces trois hommes, disons-nous, il y a une pure et lumineuse créature, une femme, une reine. Malheureuse comme femme, car elle est comme si elle n'avait pas de mari; malheureuse comme reine, car elle est comme si elle n'avait pas de roi; penchée vers ceux qui sont au-dessous d'elle par pitié royale et par instinct de femme aussi peut-être, et regardant en bas pendant que Ruy Blas, le peuple, regarde en haut.
Aux yeux de l'auteur, et sans préjudice de ce que les personnages accessoires peuvent apporter à la vérité de l'ensemble, ces quatre têtes ainsi groupées résumeraient les principales saillies qu'offrait au regard du philosophe historien la monarchie espagnole il y a cent quarante ans. A ces quatre têtes, il semble qu'on pourrait en ajouter une cinquième, celle du roi Charles II. Mais, dans l'histoire comme dans le drame, Charles II d'Espagne n'est pas une figure, c'est une ombre.
A présent, hâtons-nous de le dire, ce qu'on vient de lire n'est point l'explication de Ruy Blas. C'en est simplement un des aspects. C'est l'impression particulière que pourrait laisser ce drame, s'il valait la[p. ix] peine d'être étudié, à l'esprit grave et consciencieux qui l'examinerait, par exemple, du point de vue de la philosophie de l'histoire.
Mais, si peu qu'il soit, ce drame, comme toutes les choses de ce monde, a beaucoup d'autres aspects, et peut être envisagé de beaucoup d'autres manières. On peut prendre plusieurs vues d'une idée comme d'une montagne. Cela dépend du lieu où l'on se place. Qu'on nous passe, seulement pour rendre claire notre idée, une comparaison infiniment trop ambitieuse: le Mont-Blanc, vu de la Croix-de-Fléchères, ne ressemble pas au Mont-Blanc vu de Sallenches. Pourtant, c'est le Mont-Blanc.
De même, pour tomber d'une très-grande chose à une très-petite, ce drame, dont nous venons d'indiquer le sens historique, offrirait une tout autre figure si on le considérait d'un point de vue beaucoup plus élevé encore, du point de vue purement humain. Alors don Salluste serait l'égoïsme absolu, le souci sans repos; don César, son contraire, serait le désintéressement et l'insouciance; on verrait dans Ruy Blas le génie et la passion comprimés par la société et s'élançant d'autant plus haut que la compression est plus violente; la reine enfin, ce serait la vertu minée par l'ennui.
Au point de vue uniquement littéraire, l'aspect de cette pensée, telle quelle, intitulée: Ruy Blas, changerait encore. Les trois formes souveraines de l'art pourraient y paraître personnifiées et résumées. Don Salluste serait le Drame, don César la Comédie, Ruy Blas la Tragédie. Le drame noue l'action; la comédie l'embrouille, la tragédie la tranche.
[p. x]Tous ces aspects sont justes et vrais, mais aucun d'eux n'est complet. La vérité absolue n'est que dans l'ensemble de l'œuvre. Que chacun y trouve ce qu'il y cherche, et le poëte, qui ne s'en flatte pas du reste, aura atteint son but. Le sujet philosophique de Ruy Blas, c'est le peuple aspirant aux régions élevées; le sujet humain, c'est un homme qui aime une femme; le sujet dramatique, c'est un laquais qui aime une
reine. La foule qui se presse chaque soir devant cette œuvre, parce qu'en France jamais l'attention publique n'a fait défaut aux tentatives de l'esprit, quelles qu'elles soient d'ailleurs, la foule, disons-nous, ne voit dans Ruy Blas que ce dernier sujet, le sujet dramatique, le laquais; et elle a raison.
Et ce que nous venons de dire de Ruy Blas nous semble évident de tout autre ouvrage. Les œuvres vénérables des maîtres ont même cela de remarquable qu'elles offrent plus de faces à étudier que les autres. Tartufe fait rire ceux-ci et trembler ceux-là. Tartufe, c'est le serpent domestique; ou bien c'est l'hypocrite; ou bien c'est l'hypocrisie. C'est tantôt un homme, tantôt une idée. Othello, pour les uns, c'est un noir qui aime une blanche; pour les autres, c'est un parvenu qui a épousé une patricienne; pour ceux là, c'est un jaloux; pour ceux-ci, c'est la jalousie. Et cette diversité d'aspects n'ôte rien à l'unité fondamentale de la composition. Nous l'avons déjà dit ailleurs: mille rameaux et un tronc unique.
Si l'auteur de ce livre a particulièrement insisté sur la signification historique de Ruy Blas, c'est que dans sa pensée, par le sens historique, et, il est vrai, par le sens historique uniquement, Ruy Blas se rat[p. xi]tache à Hernani. Le grand fait de la noblesse se montre, dans Hernani comme dans Ruy Blas, à côté du grand fait de la royauté. Seulement, dans Hernani, comme la royauté absolue n'est pas faite, la noblesse lutte encore contre le roi, ici avec l'orgueil, là avec l'épée; à demi féodale, à demi rebelle. En 1519, le seigneur vit loin de la cour dans la montagne, en bandit comme Hernani, ou en patriarche comme Ruy Gomez. Deux cents ans plus tard, la question est retournée. Les vassaux sont devenus des courtisans. Et, si le seigneur sent encore d'aventure le besoin de cacher son nom, ce n'est pas pour échapper au roi, c'est pour échapper à ses créanciers. Il ne se fait pas bandit, il se fait bohémien. — On sent que la royauté absolue a passé pendant longues années sur ces nobles têtes, courbant l'une, brisant l'autre.
Et puis, qu'on nous permette ce dernier mot, entre Hernani et Ruy Blas deux siècles de l'Espagne sont encadrés; deux grands siècles, pendant lesquels il a été donné à la descendance de Charles-Quint de dominer le monde; deux siècles que la Providence, chose remarquable, n'a pas voulu allonger d'une heure, car Charles-Quint naît en 1500 et Charles II meurt en 1700. En 1700, Louis XIV héritait de Charles-Quint, comme en 1800 Napoléon héritait de Louis XIV. Ces grandes apparitions de dynasties, qui illuminent par moments l'histoire, sont pour l'auteur un beau et mélancolique spectacle sur lequel ses yeux se fixent souvent. Il essaye parfois d'en transporter quelque chose dans ses œuvres. Ainsi, il
a voulu remplir Hernani du rayonnement d'une aurore[p. xii] et couvrir Ruy Blas des ténèbres d'un crépuscule. Dans Hernani, le soleil de la maison d'Autriche se lève; dans Ruy Blas, il se couche.
Paris, 25 novembre 1838.
[p. 1]
RUY BLAS.
[p. 2]
PERSONNAGES. ACTEURS. RUY BLAS. M. Frédérick-Lemaître. DON SALLUSTE DE BAZAN. M. Alexandre Mauzin. DON CÉSAR DE BAZAN. M. Saint-Firmin. DON GURITAN. M. Féréol. LE COMTE DE CAMPOREAL. M. Montdidier. LE MARQUIS DE SANTA-CRUZ. M. Hiellard. LE MARQUIS DEL BASTO. M. Fresne. LE COMTE D'ALBE. M. Gustave. LE MARQUIS DE PRIEGO. M. Amable. DON MANUEL ARIAS. M. Hector. MONTAZGO. M. Julien. DON ANTONIO UBILLA. M. Felgines. COVADENGA. M. Victor. GUDIEL. M. Alfred. UN LAQUAIS. M. Henry. UN ALCADE. M. Beaulieu. UN HUISSIER. M. Zelger. UN ALGUAZIL. M. Adrien. DOÑA MARIA DE NEUBOURG, REINE D'ESPAGNE. Mme L. Beaudouin. LA DUCHESSE D'ALBUQUERQUE. Mme Moutin. CASILDA. Mme Mareuil. UNE DUÈGNE. Mme Louis. UN PAGE. Mme Courtois. DAMES, SEIGNEURS, CONSEILLERS PRIVÉS, PAGES, DUÈGNES, ALGUAZILS, GARDES, HUISSIERS DE CHAMBRE ET DE COUR.Madrid. — 169...
[p. 3]
ACTE PREMIER.
DON SALLUSTE.
[p. 4]
PERSONNAGES.
RUY BLAS. DON SALLUSTE DE BAZAN. DON CÉSAR DE BAZAN. LE MARQUIS DEL BASTO. LE MARQUIS DE SANTA-CRUZ. LE COMTE D'ALBE. GUDIEL. UN HUISSIER DE COUR. LA REINE. SEIGNEURS, DAMES, DUÈGNES, PAGES.[p. 5]
ACTE PREMIER.
Le salon de Danaé dans le palais du roi, à Madrid. Ameublement magnifique dans le goût demi-flamand du temps de Philippe IV. A gauche, une grande fenêtre à châssis dorés et à petits carreaux. Des
deux côtés, sur un pan coupé, une porte basse donnant dans quelque appartement intérieur. Au fond, une grande cloison vitrée à châssis dorés s'ouvrant par une large porte également vitrée sur une longue galerie. Cette galerie qui traverse tout le théâtre, est masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison vitrée. Une table, un fauteuil, et ce qu'il faut pour écrire.
Don Salluste entre par la petite porte de gauche, suivi de Ruy Blas et de Gudiel, qui porte une cassette et divers paquets qu'on dirait disposés pour un voyage. Don Salluste est vêtu de velours noir, costume de cour du temps de Charles II. La toison d'or au cou. Par-dessus l'habillement noir, un riche manteau de velours vert clair, brodé d'or et doublé de satin noir. Épée à grande coquille. Chapeau à plumes blanches. Gudiel est en noir, épée au côté. Ruy Blas est en livrée. Haut-de-chausses et justaucorps bruns. Surtout galonné, rouge et or. Tête nue. Sans épée.
SCÈNE PREMIÈRE.
DON SALLUSTE DE BAZAN, GUDIEL, par instants RUY BLAS.
DON SALLUSTE.
Ruy Blas, fermez la porte, — ouvrez cette fenêtre.
Ruy Blas obéit, puis, sur un signe de don Salluste, il sort par la porte du fond. Don Salluste va à la fenêtre.
Ils dorment encore tous ici, — le jour va naître.
[p. 6]Il se tourne brusquement vers Gudiel.
Ah! c'est un coup de foudre!.. — oui, mon règne est passé,
Gudiel! — renvoyé, disgracié, chassé! —
Ah! tout perdre en un jour! — L'aventure est secrète
Encor, n'en parle pas. — Oui, pour une amourette,
— Chose, à mon âge, sotte et folle, j'en convien! —
Avec une suivante, une fille de rien!
Séduite, beau malheur! parce que la donzelle
Est à la reine, et vient de Neubourg avec elle,
Que cette créature a pleuré contre moi,
Et traîné son enfant dans les chambres du roi;
Ordre de l'épouser. Je refuse. On m'exile!
On m'exile! Et vingt ans d'un labeur difficile,
Vingt ans d'ambition, de travaux nuit et jour;
Le président haï des alcades de cour,
Dont nul ne prononçait le nom sans épouvante;
Le chef de la maison de Bazan, qui s'en vante;
Mon crédit, mon pouvoir, tout ce que je rêvais,
Tout ce que je faisais et tout ce que j'avais:
Charge, emplois, honneurs, tout en un instant s'écroule
Au milieu des éclats de rire de la foule!
GUDIEL.
Nul ne le sait encor, monseigneur.
DON SALLUSTE.
Mais demain!
Demain, on le saura! — Nous serons en chemin!
Je ne veux pas tomber, non, je veux disparaître!
[p. 7]Il déboutonne violemment son pourpoint.
— Tu m'agrafes toujours comme on agrafe un prêtre,
Tu serres mon pourpoint, et j'étouffe, mon cher! —
Il s'assied.
Oh! mais je vais construire, et sans en avoir l'air,
Une sape profonde, obscure et souterraine!
— Chassé! —
Il se lève.
GUDIEL.
D'où vient le coup, monseigneur?
DON SALLUSTE.
De la reine.
Oh! je me vengerai, Gudiel! tu m'entends?
Toi dont je suis l'élève, et qui depuis vingt ans
M'as aidé, m'as servi dans les choses passées,
Tu sais bien jusqu'où vont dans l'ombre mes pensées,
Comme un bon architecte au coup d'œil exercé
Connaît la profondeur du puits qu'il a creusé.
Je pars. Je vais aller à Finlas, en Castille,
Dans mes États, — et là, songer! — Pour une fille!
— Toi, règle le départ, car nous sommes pressés.
Moi, je vais dire un mot au drôle que tu sais.
A tout hasard. Peut-il me servir? Je l'ignore.
Ici jusqu'à ce soir je suis le maître encore.
[p. 8]Je me vengerai, va! Comment? je ne sais pas;
Mais je veux que ce soit effrayant! — De ce pas
Va faire nos apprêts, et hâte-toi. — Silence!
Tu pars avec moi. Va.
Gudiel salue et sort.
DON SALLUSTE, appelant.
— Ruy Blas!
RUY BLAS, se présentant à la porte du fond.
Votre Excellence?
DON SALLUSTE.
Comme je ne dois plus coucher dans le palais,
Il faut laisser les clefs et clore les volets.
RUY BLAS, s'inclinant.
Monseigneur, il suffit.
DON SALLUSTE.
Écoutez, je vous prie.
La reine va passer, là, dans la galerie,
En allant de la messe à sa chambre d'honneur.
Dans deux heures, Ruy Blas, soyez-là.
RUY BLAS.
Monseigneur,
J'y serai.
[p. 9]DON SALLUSTE, à la fenêtre.
Voyez-vous cet homme dans la place
Qui montre au gens de garde un papier, et qui passe?
Faites-lui, sans parler, signe qu'il peut monter,
Par l'escalier étroit.
Ruy Blas obéit. Don Salluste continue en lui montrant la petite porte à droite.
— Avant de nous quitter,
Dans cette chambre où sont les hommes de police,
Voyez donc si les trois alguazils de service
Sont éveillés.
RUY BLAS.
Il va à la porte, l'entr'ouvre et revient.
Seigneur, ils dorment.
DON SALLUSTE.
Parlez bas.
J'aurai besoin de vous, ne vous éloignez pas.
Faites le guet afin que les fâcheux nous laissent.
Entre don César de Bazan. Chapeau défoncé. Grande cape déguenillée qui ne laisse voir de sa toilette que des bas mal tirés et des souliers crevés. Épée de spadassin.
Au moment où il entre, lui et Ruy Blas se regardent et font en même temps, chacun de leur côté, un geste de surprise.
DON SALLUSTE, les observant, à part.
Ils se sont regardés! Est-ce qu'ils se connaissent?
Ruy Blas sort.
[p. 10]SCÈNE DEUXIÈME.
DON SALLUSTE, DON CÉSAR.
DON SALLUSTE.
Ah! vous voilà, bandit!
DON CÉSAR.
Oui, cousin, me voilà.
DON SALLUSTE.
C'est grand plaisir de voir un gueux comme cela!
DON CÉSAR, saluant.
Je suis charmé...
DON SALLUSTE.
Monsieur, on sait de vos histoires.
DON CÉSAR, gracieusement.
Qui sont de votre goût?
DON SALLUSTE.
Oui, des plus méritoires.
[p. 11]Don Charles de Mira l'autre nuit fut volé.
On lui prit son épée à fourreau ciselé
Et son buffle. C'était la surveille de Pâques.
Seulement, comme il est chevalier de Saint-Jacques,
La bande lui laissa son manteau.
DON CÉSAR.
Doux Jésus!
Pourquoi?
DON SALLUSTE.
Parce que l'ordre était brodé dessus.
Eh bien! que dites-vous de l'algarade?
DON CÉSAR.
Ah! diable!
Je dis que nous vivons dans un siècle effroyable!
Qu'allons-nous devenir, bon Dieu! si les voleurs
Vont courtiser saint Jacque et le mettre des leurs?
DON SALLUSTE.
Vous en étiez!
DON CÉSAR.
Hé bien — oui! s'il faut que je parle,
J'étais là. Je n'ai pas touché votre don Charle.
J'ai donné seulement des conseils.
[p. 12]DON SALLUSTE.
Mieux encor.
La lune étant couchée, hier, Plaza-Mayor,
Toutes sortes de gens, sans coiffe et sans semelle,
Qui hors d'un bouge affreux se ruaient pêle-mêle,
Ont attaqué le guet. — Vous en étiez!
DON CÉSAR.
Cousin,
J'ai toujours dédaigné de battre un argousin.
J'étais là. Rien de plus. Pendant les estocades,
Je marchais en faisant des vers sous les arcades.
On s'est fort assommé.
DON SALLUSTE.
Ce n'est pas tout.
DON CÉSAR.
Voyons.
DON SALLUSTE.
En France, on vous accuse, entr'autres actions,
Avec vos compagnons à toute loi rebelles,
D'avoir ouvert sans clef la caisse des gabelles.
DON CÉSAR.
Je ne dis pas. — La France est pays ennemi.
[p. 13]
DON SALLUSTE.
En Flandre, rencontrant dom Paul Barthélemy,
Lequel portait à Mons le produit d'un vignoble
Qu'il venait de toucher pour le chapitre noble,
Vous avez mis la main sur l'argent du clergé.
DON CÉSAR.
En Flandre? — il se peut bien. J'ai beaucoup voyagé.
— Est-ce tout?
DON SALLUSTE.
Don César, la sueur de la honte,
Lorsque je pense à vous, à la face me monte.
DON CÉSAR.
Bon. Laissez-la monter.
DON SALLUSTE.
Notre famille...
DON CÉSAR.
Non.
Car vous seul à Madrid connaissez mon vrai nom.
Ainsi ne parlons pas famille!
DON SALLUSTE.
Une marquise
Me disait l'autre jour en sortant de l'église:
[p. 14] — Quel est donc ce brigand, qui, là-bas, nez au vent,
Se carre, l'œil au guet et la hanche en avant,
Plus délabré que Job et plus fier que Bragance,
Drapant sa gueuserie avec son arrogance,
Et qui, froissant du poing sous sa manche en haillons,
L'épée à lourd pommeau qui lui bat les talons,
Promène, d'une mine altière et magistrale,
Sa cape en dents de scie et ses bas en spirale?
DON CÉSAR, jetant un coup d'œil sur sa toilette.
Vous avez répondu: C'est ce cher Zafari!
DON SALLUSTE.
Non; j'ai rougi, monsieur!
DON CÉSAR.
Eh bien! la dame a ri.
Voilà. J'aime beaucoup faire rire les femmes.
DON SALLUSTE.
Vous n'allez fréquentant que spadassins infâmes!
DON CÉSAR.
Des clercs! des écoliers doux comme des moutons!
DON SALLUSTE.
Partout on vous rencontre avec des Jeannetons!
[p. 15]
DON CÉSAR.
O Lucindes d'amour! ô douces Isabelles!
Eh bien! sur votre compte on en entend de belles!
Quoi! l'on vous traite ainsi, beautés à l'œil mutin,
A qui je dis le soir mes sonnets du matin!
DON SALLUSTE.
Enfin, Matalobos, ce voleur de Galice
Qui désole Madrid malgré notre police,
Il est de vos amis!
DON CÉSAR.
Raisonnons, s'il vous plaît.
Sans lui j'irais tout nu, ce qui serait fort laid.
Me voyant sans habit, dans la rue, en décembre,
La chose le toucha. — Ce fat parfumé d'ambre,
Le comte d'Albe, à qui l'autre mois fut volé
Son beau pourpoint de soie...
DON SALLUSTE.
Eh bien?
DON CÉSAR.
C'est moi qui l'ai.
Matalobos me l'a donné.
[p. 16]DON SALLUSTE.
L'habit du comte!
Vous n'êtes pas honteux?...
DON CÉSAR.
Je n'aurai jamais honte
De mettre un bon pourpoint, brodé, passementé,
Qui me tient chaud l'hiver et me fait beau l'été.
— Voyez, il est tout neuf. —
Il entr'ouvre son manteau qui laisse voir un superbe pourpoint de satin rose brodé d'or.
Les poches en sont pleines
De billets doux au comte adressés par centaines.
Souvent, pauvre, amoureux, n'ayant rien sous la dent,
J'avise une cuisine au soupirail ardent
D'où la vapeur des mets aux narines me monte;
Je m'assieds là, j'y lis les billets doux du comte,
Et, trompant l'estomac et le cœur tour à tour,
J'ai l'odeur du festin et l'ombre de l'amour!
DON SALLUSTE.
Don César...
DON CÉSAR.
Mon cousin, tenez, trêve aux reproches.
Je suis un grand seigneur, c'est vrai, l'un de vos proches;
[p. 17]Je m'appelle César, comte de Garofa;
Mais le sort de folie en naissant me coiffa.
J'étais riche, j'avais des palais, des domaines,
Je pouvais largement renier les Célimènes.
Bah! mes vingt ans n'étaient pas encore révolus
Que j'avais mangé tout! il ne me restait plus
De mes prospérités, ou réelles, ou fausses,
Qu'un tas de créanciers hurlant après mes chausses.
Ma foi, j'ai pris la fuite et j'ai changé de nom.
A présent, je ne suis qu'un joyeux compagnon,
Zafari, que, hors vous, nul ne peut reconnaître.
Vous ne me donnez pas du tout d'argent, mon maître;
Je m'en passe. Le soir, le front sur un pavé,
Devant l'ancien palais des comtes de Tevé,
— C'est là, depuis neuf ans, que la nuit je m'arrête. —
Je vais dormir avec le ciel bleu sur ma tête.
Je suis heureux ainsi. Pardieu, c'est un beau sort!
Tout le monde me croit dans l'Inde, au diable, — mort.
La fontaine voisine a de l'eau, j'y vais boire,
Et puis je me promène avec un air de gloire.
Mon palais, d'où jadis mon argent s'envola,
Appartient à cette heure au nonce Espinola,
C'est bien. Quand par hasard jusque-là je m'enfonce,
Je donne des avis aux ouvriers du nonce
Occupés à sculpter sur la porte un Bacchus. —
Maintenant, pouvez-vous me prêter dix écus?
DON SALLUSTE.
Écoutez-moi...
[p. 18]DON CÉSAR, croisant les bras.
Voyons à présent votre style.
DON SALLUSTE.
Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile
César, sans enfants, riche, et de plus votre aîné.
Je vous vois à regret vers l'abîme entraîné,
Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes,
Vous êtes malheureux. Je veux payer vos dettes,
Vous rendre vos palais, vous remettre à la cour,
Et refaire de vous un beau seigneur d'amour.
Que Zafari s'éteigne et que César renaisse.
Je veux qu'à votre gré vous puisiez dans ma caisse,
Sans crainte, à pleines mains, sans soin de l'avenir.
Quand on a des parents il faut les soutenir,
César, et pour les siens se montrer pitoyable...
Pendant que don Salluste parle, le visage de don César prend une expression de plus en plus étonnée, joyeuse et confiante; enfin il éclate.
DON CÉSAR.
Vous avez toujours eu de l'esprit comme un diable,
Et c'est fort éloquent ce que vous dites là.
— Continuez!
DON SALLUSTE.
César, je ne mets à cela
[p. 19]Qu'une condition. — Dans l'instant je m'explique.
Prenez d'abord ma bourse.
DON CÉSAR, empoignant la bourse qui est pleine d'or.
Ah çà! c'est magnifique!
DON SALLUSTE.
Et je vais vous donner cinq cents ducats...
DON CÉSAR, ébloui.
Marquis!
DON SALLUSTE, continuant.
Dès aujourd'hui!
DON CÉSAR.
Pardieu, je vous suis tout acquis.
Quant aux conditions, ordonnez. Foi de brave!
Mon épée est à vous. Je deviens votre esclave,
Et, si cela vous plaît, j'irai croiser le fer
Avec don Spavento, capitan de l'enfer.
DON SALLUSTE.
Non, je n'accepte pas, don César, et pour cause,
Votre épée.
[p. 20]DON CÉSAR.
Alors quoi? je n'ai guère autre chose.
DON SALLUSTE, se rapprochant de lui et baissant la voix.
Vous connaissez, — et c'est en ce cas un bonheur, —
Tous les gueux de Madrid?
DON CÉSAR.
Vous me faites honneur.
DON SALLUSTE.
Vous en traînez toujours après vous une meute;
Vous pourriez, au besoin, soulever une émeute,
Je le sais. Tout cela peut-être servira.
DON CÉSAR, éclatant de rire.
D'honneur! vous avez l'air de faire un opéra.
Quelle part donnez-vous dans l'œuvre à mon génie?
Sera-ce le poème ou bien la symphonie?
Commandez. Je suis fort pour le charivari.
DON SALLUSTE, gravement.
Je parle à don César et non à Zafari.
Baissant la voix de plus en plus.
Écoute. J'ai besoin, pour un résultat sombre,
[p. 21]De quelqu'un qui travaille à mon côté dans l'ombre
Et qui m'aide à bâtir un grand événement.
Je ne suis pas méchant, mais il est tel moment
Où le plus délicat, quittant toute vergogne,
Doit retrousser sa manche et faire la besogne.
Tu seras riche, mais il faut m'aider sans bruit
A dresser, comme font les oiseleurs la nuit,
Un bon filet caché sous un miroir qui brille,
Un piége d'alouette ou bien de jeune fille.
Il faut, par quelque plan terrible et merveilleux,
— Tu n'es pas, que je pense, un homme scrupuleux, —
Me venger!
DON CÉSAR.
Vous venger?
DON SALLUSTE.